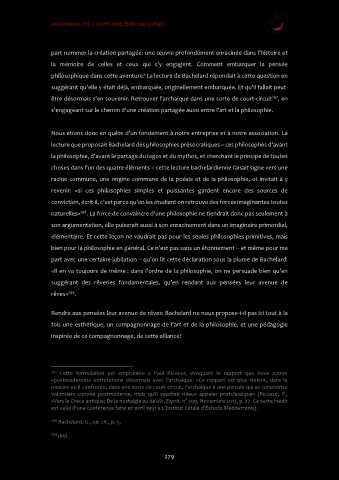Page 279 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 279
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
part nommer la création partagée: une œuvre profondément enracinée dans l’histoire et
la mémoire de celles et ceux qui s’y engagent. Comment embarquer la pensée
philosophique dans cette aventure? La lecture de Bachelard répondait à cette question en
suggérant qu’elle y était déjà, embarquée, originellement embarquée. Et qu’il fallait peut-
297
être désormais s’en souvenir. Retrouver l’archaïque dans une sorte de court-circuit , en
s’engageant sur le chemin d’une création partagée aussi entre l’art et la philosophie.
Nous étions donc en quête d’un fondement à notre entreprise et à notre association. La
lecture que proposait Bachelard des philosophies présocratiques – ces philosophes d’avant
la philosophie, d’avant le partage du logos et du mythos, et cherchant le principe de toutes
choses dans l’un des quatre éléments – cette lecture bachelardienne faisait signe vers une
racine commune, une origine commune de la poésie et de la philosophie, et invitait à y
revenir: «si ces philosophies simples et puissantes gardent encore des sources de
conviction, écrit-il, c’est parce qu’en les étudiant on retrouve des forces imaginantes toutes
298
naturelles» . La force de convaincre d’une philosophie ne tiendrait donc pas seulement à
son argumentation, elle puiserait aussi à son enracinement dans un imaginaire primordial,
élémentaire. Et cette leçon ne vaudrait pas pour les seules philosophies primitives, mais
bien pour la philosophie en général. Ce n’est pas sans un étonnement – et même pour ma
part avec une certaine jubilation – qu’on lit cette déclaration sous la plume de Bachelard:
«Il en va toujours de même : dans l’ordre de la philosophie, on ne persuade bien qu’en
suggérant des rêveries fondamentales, qu’en rendant aux pensées leur avenue de
299
rêves» .
Rendre aux pensées leur avenue de rêves: Bachelard ne nous propose-t-il pas ici tout à la
fois une esthétique, un compagnonnage de l’art et de la philosophie, et une pédagogie
inspirée de ce compagnonnage, de cette alliance?
297 Cette formulation est empruntée à Paul Ricoeur, évoquant le rapport que nous autres
«postmodernes» entretenons désormais avec l’archaïque: «Ce rapport est plus violent, dans la
mesure où il confronte, dans une sorte de court-circuit, l’archaïque à une pensée qui se caractérise
volontiers comme postmoderne, mais qu’il vaudrait mieux appeler postclassique» (Ricoeur, P.,
«Vers la Grèce antique; De la nostalgie au deuil», Esprit, n° 399, Νovembre 2013, p. 27. Ce texte inédit
est celui d’une conférence faite en avril 1991 à L’Institut Català d’Estudis Mediterranis).
298
Bachelard, G., op. cit., p. 5.
299 Ibid.
279