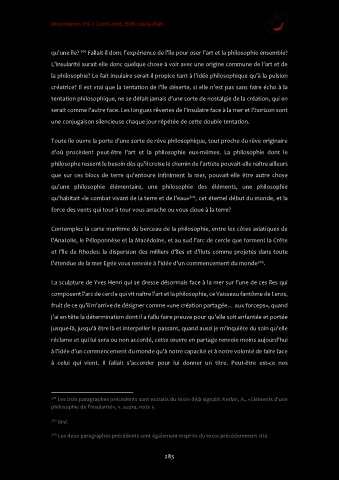Page 283 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 283
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
301
qu’une île? Fallait-il donc l’expérience de l’île pour oser l’art et la philosophie ensemble?
L’insularité aurait-elle donc quelque chose à voir avec une origine commune de l’art et de
la philosophie? Le fait insulaire serait-il propice tant à l’idée philosophique qu’à la pulsion
créatrice? Il est vrai que la tentation de l’île déserte, si elle n’est pas sans faire écho à la
tentation philosophique, ne se défait jamais d’une sorte de nostalgie de la création, qui en
serait comme l’autre face. Les longues rêveries de l’insulaire face à la mer et l’horizon sont
une conjugaison silencieuse chaque jour répétée de cette double tentation.
Toute île ouvre la porte d’une sorte de rêve philosophique, tout proche du rêve originaire
d’où procèdent peut-être l’art et la philosophie eux-mêmes. La philosophie dont le
philosophe ressent le besoin dès qu’il croise le chemin de l’artiste pouvait-elle naître ailleurs
que sur ces blocs de terre qu’entoure infiniment la mer, pouvait-elle être autre chose
qu’une philosophie élémentaire, une philosophie des éléments, une philosophie
302
qu’habitait «le combat vivant de la terre et de l’eau» , cet éternel début du monde, et la
force des vents qui tour à tour vous arrache ou vous cloue à la terre?
Contemplez la carte maritime du berceau de la philosophie, entre les côtes asiatiques de
l’Anatolie, le Péloponnèse et la Macédoine, et au sud l’arc de cercle que forment la Crête
et l’île de Rhodes: la dispersion des milliers d’îles et d’îlots comme projetés dans toute
303
l’étendue de la mer Egée vous renvoie à l’idée d’un commencement du monde .
La sculpture de Yves Henri qui se dresse désormais face à la mer sur l’une de ces îles qui
composent l’arc de cercle qui vit naître l’art et la philosophie, ce Vaisseau fantôme de Leros,
fruit de ce qu’il m’arrive de désigner comme «une création partagée… aux forceps», quand
j’ai en tête la détermination dont il a fallu faire preuve pour qu’elle soit enfantée et portée
jusque-là, jusqu’à être là et interpeller le passant, quand aussi je m’inquiète du soin qu’elle
réclame et qui lui sera ou non accordé, cette œuvre en partage renvoie moins aujourd’hui
à l’idée d’un commencement du monde qu’à notre capacité et à notre volonté de faire face
à celui qui vient. Il fallait s’accorder pour lui donner un titre. Peut-être est-ce nos
301 Les trois paragraphes précédents sont extraits du texte déjà signalé: Kerlan, A., «Eléments d’une
philosophie de l’insularité», v. supra, note 5.
302
Ibid.
303 Les deux paragraphes précédents sont également inspirés du texte précédemment cité.
283