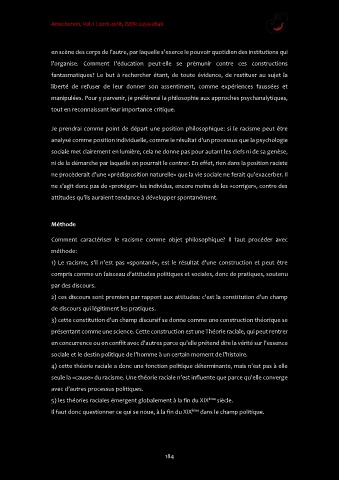Page 184 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 184
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
en scène des corps de l’autre, par laquelle s’exerce le pouvoir quotidien des institutions qui
l’organise. Comment l’éducation peut-elle se prémunir contre ces constructions
fantasmatiques? Le but à rechercher étant, de toute évidence, de restituer au sujet la
liberté de refuser de leur donner son assentiment, comme expériences faussées et
manipulées. Pour y parvenir, je préférerai la philosophie aux approches psychanalytiques,
tout en reconnaissant leur importance critique.
Je prendrai comme point de départ une position philosophique: si le racisme peut être
analysé comme position individuelle, comme le résultat d’un processus que la psychologie
sociale met clairement en lumière, cela ne donne pas pour autant les clefs ni de sa genèse,
ni de la démarche par laquelle on pourrait le contrer. En effet, rien dans la position raciste
ne procèderait d’une «prédisposition naturelle» que la vie sociale ne ferait qu’exacerber. Il
ne s’agit donc pas de «protéger» les individus, encore moins de les «corriger», contre des
attitudes qu’ils auraient tendance à développer spontanément.
Méthode
Comment caractériser le racisme comme objet philosophique? Il faut procéder avec
méthode:
1) Le racisme, s’il n’est pas «spontané», est le résultat d’une construction et peut être
compris comme un faisceau d’attitudes politiques et sociales, donc de pratiques, soutenu
par des discours.
2) ces discours sont premiers par rapport aux attitudes: c’est la constitution d’un champ
de discours qui légitiment les pratiques.
3) cette constitution d’un champ discursif se donne comme une construction théorique se
présentant comme une science. Cette construction est une Théorie raciale, qui peut rentrer
en concurrence ou en conflit avec d’autres parce qu’elle prétend dire la vérité sur l’essence
sociale et le destin politique de l’homme à un certain moment de l’histoire.
4) cette théorie raciale a donc une fonction politique déterminante, mais n’est pas à elle
seule la «cause» du racisme. Une théorie raciale n’est influente que parce qu’elle converge
avec d’autres processus politiques.
5) les théories raciales émergent globalement à la fin du XIX ème siècle.
Il faut donc questionner ce qui se noue, à la fin du XIX ème dans le champ politique.
184