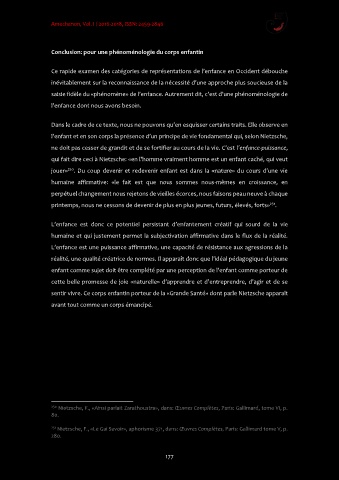Page 177 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 177
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
Conclusion: pour une phénoménologie du corps enfantin
Ce rapide examen des catégories de représentations de l’enfance en Occident débouche
inévitablement sur la reconnaissance de la nécessité d’une approche plus soucieuse de la
saisie fidèle du «phénomène» de l’enfance. Autrement dit, c’est d’une phénoménologie de
l’enfance dont nous avons besoin.
Dans le cadre de ce texte, nous ne pouvons qu’en esquisser certains traits. Elle observe en
l’enfant et en son corps la présence d’un principe de vie fondamental qui, selon Nietzsche,
ne doit pas cesser de grandit et de se fortifier au cours de la vie. C’est l’enfance-puissance,
qui fait dire ceci à Nietzsche: «en l’homme vraiment homme est un enfant caché, qui veut
250
jouer» . Du coup devenir et redevenir enfant est dans la «nature» du cours d’une vie
humaine affirmative: «le fait est que nous sommes nous-mêmes en croissance, en
perpétuel changement nous rejetons de vieilles écorces, nous faisons peau neuve à chaque
251
printemps, nous ne cessons de devenir de plus en plus jeunes, futurs, élevés, forts» .
L’enfance est donc ce potentiel persistant d’enfantement créatif qui sourd de la vie
humaine et qui justement permet la subjectivation affirmative dans le flux de la réalité.
L’enfance est une puissance affirmative, une capacité de résistance aux agressions de la
réalité, une qualité créatrice de normes. Il apparaît donc que l’idéal pédagogique du jeune
enfant comme sujet doit être complété par une perception de l’enfant comme porteur de
cette belle promesse de joie «naturelle» d’apprendre et d’entreprendre, d’agir et de se
sentir vivre. Ce corps enfantin porteur de la «Grande Santé» dont parle Nietzsche apparaît
avant tout comme un corps émancipé.
250 Nietzsche, F., «Ainsi parlait Zarathoustra», dans: Œuvres Complètes, Paris: Gallimard, tome VI, p.
80.
251 Nietzsche, F., «Le Gai Savoir», aphorisme 371, dans: Œuvres Complètes, Paris: Gallimard tome V, p.
280.
177