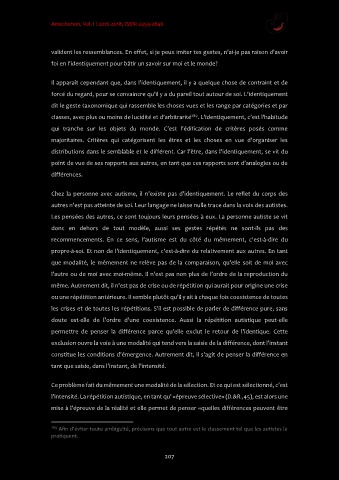Page 207 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 207
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
valident les ressemblances. En effet, si je peux imiter tes gestes, n’ai-je pas raison d’avoir
foi en l’identiquement pour bâtir un savoir sur moi et le monde?
Il apparaît cependant que, dans l’identiquement, il y a quelque chose de contraint et de
forcé du regard, pour se convaincre qu’il y a du pareil tout autour de soi. L’identiquement
dit le geste taxonomique qui rassemble les choses vues et les range par catégories et par
289
classes, avec plus ou moins de lucidité et d’arbitrarité . L’identiquement, c’est l’habitude
qui tranche sur les objets du monde. C’est l’édification de critères posés comme
majoritaires. Critères qui catégorisent les êtres et les choses en vue d’organiser les
distributions dans le semblable et le différent. Car l’être, dans l’identiquement, se vit du
point de vue de ses rapports aux autres, en tant que ces rapports sont d’analogies ou de
différences.
Chez la personne avec autisme, il n’existe pas d’identiquement. Le reflet du corps des
autres n’est pas atteinte de soi. Leur langage ne laisse nulle trace dans la voix des autistes.
Les pensées des autres, ce sont toujours leurs pensées à eux. La personne autiste se vit
donc en dehors de tout modèle, aussi ses gestes répétés ne sont-ils pas des
recommencements. En ce sens, l’autisme est du côté du mêmement, c'est-à-dire du
propre-à-soi. Et non de l’identiquement, c'est-à-dire du relativement aux autres. En tant
que modalité, le mêmement ne relève pas de la comparaison, qu’elle soit de moi avec
l’autre ou de moi avec moi-même. Il n’est pas non plus de l’ordre de la reproduction du
même. Autrement dit, il n’est pas de crise ou de répétition qui aurait pour origine une crise
ou une répétition antérieure. Il semble plutôt qu’il y ait à chaque fois coexistence de toutes
les crises et de toutes les répétitions. S’il est possible de parler de différence pure, sans
doute est-elle de l’ordre d’une coexistence. Aussi la répétition autistique peut-elle
permettre de penser la différence parce qu’elle exclut le retour de l’identique. Cette
exclusion ouvre la voie à une modalité qui tend vers la saisie de la différence, dont l’instant
constitue les conditions d’émergence. Autrement dit, il s’agit de penser la différence en
tant que saisie, dans l’instant, de l’intensité.
Ce problème fait du mêmement une modalité de la sélection. Et ce qui est sélectionné, c’est
l’intensité. La répétition autistique, en tant qu’ «épreuve sélective» (D.&R.,45), est alors une
mise à l’épreuve de la réalité et elle permet de penser «quelles différences peuvent être
289 Afin d’éviter toute ambiguïté, précisons que tout autre est le classement tel que les autistes le
pratiquent.
207