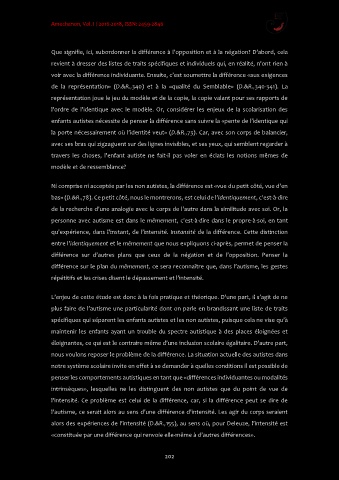Page 202 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 202
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
Que signifie, ici, subordonner la différence à l’opposition et à la négation? D’abord, cela
revient à dresser des listes de traits spécifiques et individuels qui, en réalité, n’ont rien à
voir avec la différence individuante. Ensuite, c’est soumettre la différence «aux exigences
de la représentation» (D.&R.,340) et à la «qualité du Semblable» (D.&R.,340-341). La
représentation joue le jeu du modèle et de la copie, la copie valant pour ses rapports de
l’ordre de l’identique avec le modèle. Or, considérer les enjeux de la scolarisation des
enfants autistes nécessite de penser la différence sans suivre la «pente de l’identique qui
la porte nécessairement où l’identité veut» (D.&R.,73). Car, avec son corps de balancier,
avec ses bras qui zigzaguent sur des lignes invisibles, et ses yeux, qui semblent regarder à
travers les choses, l’enfant autiste ne fait-il pas voler en éclats les notions mêmes de
modèle et de ressemblance?
Ni comprise ni acceptée par les non autistes, la différence est «vue du petit côté, vue d’en
bas» (D.&R.,78). Ce petit côté, nous le montrerons, est celui de l’identiquement, c'est-à-dire
de la recherche d’une analogie avec le corps de l’autre dans la similitude avec soi. Or, la
personne avec autisme est dans le mêmement, c'est-à-dire dans le propre-à-soi, en tant
qu’expérience, dans l’instant, de l’intensité. Instansité de la différence. Cette distinction
entre l’identiquement et le mêmement que nous expliquons ci-après, permet de penser la
différence sur d’autres plans que ceux de la négation et de l’opposition. Penser la
différence sur le plan du mêmement, ce sera reconnaître que, dans l’autisme, les gestes
répétitifs et les crises disent le dépassement et l’intensité.
L’enjeu de cette étude est donc à la fois pratique et théorique. D’une part, il s’agit de ne
plus faire de l’autisme une particularité dont on parle en brandissant une liste de traits
spécifiques qui séparent les enfants autistes et les non autistes, puisque cela ne vise qu’à
maintenir les enfants ayant un trouble du spectre autistique à des places éloignées et
éloignantes, ce qui est le contraire même d’une inclusion scolaire égalitaire. D’autre part,
nous voulons reposer le problème de la différence. La situation actuelle des autistes dans
notre système scolaire invite en effet à se demander à quelles conditions il est possible de
penser les comportements autistiques en tant que «différences individuantes ou modalités
intrinsèques», lesquelles ne les distinguent des non autistes que du point de vue de
l’intensité. Ce problème est celui de la différence, car, si la différence peut se dire de
l’autisme, ce serait alors au sens d’une différence d’intensité. Les agir du corps seraient
alors des expériences de l’intensité (D.&R.,155), au sens où, pour Deleuze, l’intensité est
«constituée par une différence qui renvoie elle-même à d’autres différences».
202