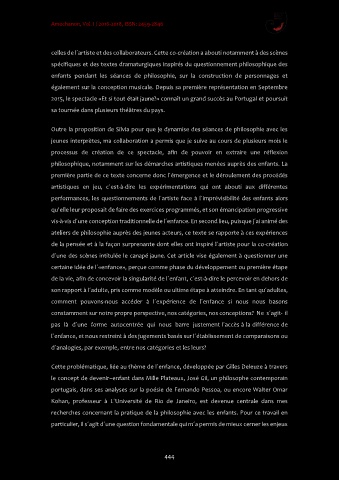Page 444 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 444
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
celles de l´artiste et des collaborateurs. Cette co-création a abouti notamment à des scènes
spécifiques et des textes dramaturgiques inspirés du questionnement philosophique des
enfants pendant les séances de philosophie, sur la construction de personnages et
également sur la conception musicale. Depuis sa première représentation en Septembre
2015, le spectacle «Et si tout était jaune?» connaît un grand succès au Portugal et poursuit
sa tournée dans plusieurs théâtres du pays.
Outre la proposition de Silvia pour que je dynamise des séances de philosophie avec les
jeunes interprètes, ma collaboration a permis que je suive au cours de plusieurs mois le
processus de création de ce spectacle, afin de pouvoir en extraire une réflexion
philosophique, notamment sur les démarches artistiques menées auprès des enfants. La
première partie de ce texte concerne donc l´émergence et le déroulement des procédés
artistiques en jeu, c´est-à-dire les expérimentations qui ont abouti aux différentes
performances, les questionnements de l´artiste face à l´imprévisibilité des enfants alors
qu'elle leur proposait de faire des exercices programmés, et son émancipation progressive
vis-à-vis d´une conception traditionnelle de l´enfance. En second lieu, puisque j´ai animé des
ateliers de philosophie auprès des jeunes acteurs, ce texte se rapporte à ces expériences
de la pensée et à la façon surprenante dont elles ont inspiré l´artiste pour la co-création
d´une des scènes intitulée le canapé jaune. Cet article vise également à questionner une
certaine idée de l´«enfance», perçue comme phase du développement ou première étape
de la vie, afin de concevoir la singularité de l´enfant, c´est-à-dire le percevoir en dehors de
son rapport à l´adulte, pris comme modèle ou ultime étape à atteindre. En tant qu´adultes,
comment pouvons-nous accéder à l´expérience de l´enfance si nous nous basons
constamment sur notre propre perspective, nos catégories, nos conceptions? Ne s´agit- il
pas là d´une forme autocentrée qui nous barre justement l´accès à la différence de
l´enfance, et nous restreint à des jugements basés sur l´établissement de comparaisons ou
d´analogies, par exemple, entre nos catégories et les leurs?
Cette problématique, liée au thème de l´enfance, développée par Gilles Deleuze à travers
le concept de devenir–enfant dans Mille Plateaux, José Gil, un philosophe contemporain
portugais, dans ses analyses sur la poésie de Fernando Pessoa, ou encore Walter Omar
Kohan, professeur à L´Université de Rio de Janeiro, est devenue centrale dans mes
recherches concernant la pratique de la philosophie avec les enfants. Pour ce travail en
particulier, il s´agit d´une question fondamentale qui m´a permis de mieux cerner les enjeux
444