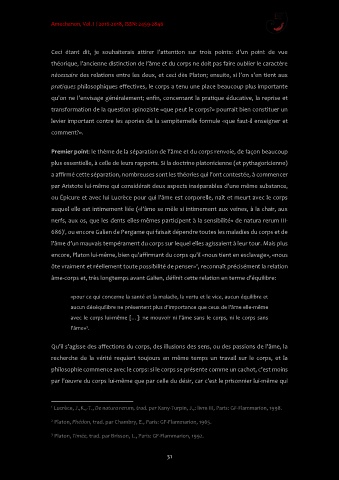Page 31 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 31
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
Ceci étant dit, je souhaiterais attirer l’attention sur trois points: d’un point de vue
théorique, l’ancienne distinction de l’âme et du corps ne doit pas faire oublier le caractère
nécessaire des relations entre les deux, et ceci dès Platon; ensuite, si l’on s’en tient aux
pratiques philosophiques effectives, le corps a tenu une place beaucoup plus importante
qu’on ne l’envisage généralement; enfin, concernant la pratique éducative, la reprise et
transformation de la question spinoziste «que peut le corps?» pourrait bien constituer un
levier important contre les apories de la sempiternelle formule «que faut-il enseigner et
comment?».
Premier point: le thème de la séparation de l’âme et du corps renvoie, de façon beaucoup
plus essentielle, à celle de leurs rapports. Si la doctrine platonicienne (et pythagoricienne)
a affirmé cette séparation, nombreuses sont les théories qui l’ont contestée, à commencer
par Aristote lui-même qui considérait deux aspects inséparables d’une même substance,
ou Épicure et avec lui Lucrèce pour qui l’âme est corporelle, naît et meurt avec le corps
auquel elle est intimement liée («l’âme se mêle si intimement aux veines, à la chair, aux
nerfs, aux os, que les dents elles-mêmes participent à la sensibilité» de natura rerum III-
1
686) , ou encore Galien de Pergame qui faisait dépendre toutes les maladies du corps et de
l’âme d’un mauvais tempérament du corps sur lequel elles agissaient à leur tour. Mais plus
encore, Platon lui-même, bien qu’affirmant du corps qu’il «nous tient en esclavage», «nous
2
ôte vraiment et réellement toute possibilité de penser» , reconnaît précisément la relation
âme-corps et, très longtemps avant Galien, définit cette relation en terme d’équilibre:
«pour ce qui concerne la santé et la maladie, la vertu et le vice, aucun équilibre et
aucun déséquilibre ne présentent plus d’importance que ceux de l’âme elle-même
avec le corps lui-même […]: ne mouvoir ni l’âme sans le corps, ni le corps sans
3
l’âme» .
Qu’il s’agisse des affections du corps, des illusions des sens, ou des passions de l’âme, la
recherche de la vérité requiert toujours en même temps un travail sur le corps, et la
philosophie commence avec le corps: si le corps se présente comme un cachot, c’est moins
par l’œuvre du corps lui-même que par celle du désir, car c’est le prisonnier lui-même qui
1 Lucrèce, J.,K.,-T., De natura rerum, trad. par Kany-Turpin, J.,: livre III, Paris: GF-Flammarion, 1998.
2 Platon, Phédon, trad. par Chambry, E., Paris: GF-Flammarion, 1965.
3 Platon, Timée, trad. par Brisson, L., Paris: GF-Flammarion, 1992.
31