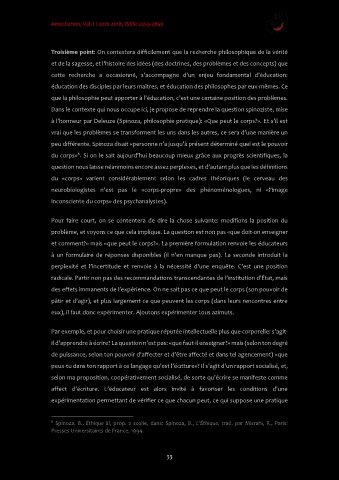Page 33 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 33
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
Troisième point: On contestera difficilement que la recherche philosophique de la vérité
et de la sagesse, et l’histoire des idées (des doctrines, des problèmes et des concepts) que
cette recherche a occasionné, s’accompagne d’un enjeu fondamental d’éducation:
éducation des disciples par leurs maîtres, et éducation des philosophes par eux-mêmes. Ce
que la philosophie peut apporter à l’éducation, c’est une certaine position des problèmes.
Dans le contexte qui nous occupe ici, je propose de reprendre la question spinoziste, mise
à l’honneur par Deleuze (Spinoza, philosophie pratique): «Que peut le corps?». Et s’il est
vrai que les problèmes se transforment les uns dans les autres, ce sera d’une manière un
peu différente. Spinoza disait «personne n’a jusqu’à présent déterminé quel est le pouvoir
8
du corps» . Si on le sait aujourd’hui beaucoup mieux grâce aux progrès scientifiques, la
question nous laisse néanmoins encore assez perplexes, et d’autant plus que les définitions
du «corps» varient considérablement selon les cadres théoriques (le cerveau des
neurobiologistes n’est pas le «corps-propre» des phénoménologues, ni «l’image
inconsciente du corps» des psychanalystes).
Pour faire court, on se contentera de dire la chose suivante: modifions la position du
problème, et voyons ce que cela implique. La question est non pas «que doit-on enseigner
et comment?» mais «que peut le corps?». La première formulation renvoie les éducateurs
à un formulaire de réponses disponibles (il n’en manque pas). La seconde introduit la
perplexité et l’incertitude et renvoie à la nécessité d’une enquête. C’est une position
radicale. Partir non pas des recommandations transcendantes de l’institution d’État, mais
des effets immanents de l’expérience. On ne sait pas ce que peut le corps (son pouvoir de
pâtir et d’agir), et plus largement ce que peuvent les corps (dans leurs rencontres entre
eux), il faut donc expérimenter. Ajoutons expérimenter tous azimuts.
Par exemple, et pour choisir une pratique réputée intellectuelle plus que corporelle: s’agit-
il d’apprendre à écrire? La question n’est pas: «que faut-il enseigner?» mais (selon ton degré
de puissance, selon ton pouvoir d’affecter et d’être affecté et dans tel agencement) «que
peux-tu dans ton rapport à ce langage qu’est l’écriture»? Il s’agit d’un rapport socialisé, et,
selon ma proposition, coopérativement socialisé, de sorte qu’écrire se manifeste comme
affect d’écriture. L’éducateur est alors invité à favoriser les conditions d’une
expérimentation permettant de vérifier ce que chacun peut, ce qui suppose une pratique
8 Spinoza, B., Éthique III, prop. 2 scolie, dans: Spinoza, B., L’Éthique, trad. par Misrahi, R., Paris:
Presses Universitaires de France, 1994.
33