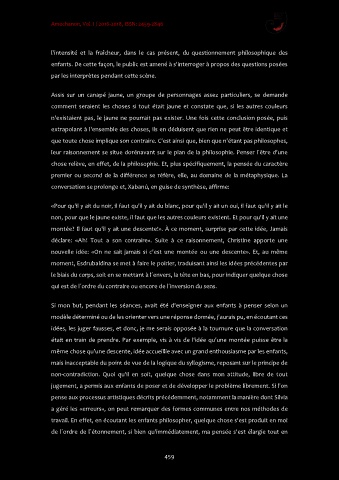Page 459 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 459
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
l'intensité et la fraîcheur, dans le cas présent, du questionnement philosophique des
enfants. De cette façon, le public est amené à s'interroger à propos des questions posées
par les interprètes pendant cette scène.
Assis sur un canapé jaune, un groupe de personnages assez particuliers, se demande
comment seraient les choses si tout était jaune et constate que, si les autres couleurs
n'existaient pas, le jaune ne pourrait pas exister. Une fois cette conclusion posée, puis
extrapolant à l'ensemble des choses, ils en déduisent que rien ne peut être identique et
que toute chose implique son contraire. C'est ainsi que, bien que n'étant pas philosophes,
leur raisonnement se situe dorénavant sur le plan de la philosophie. Penser l´être d'une
chose relève, en effet, de la philosophie. Et, plus spécifiquement, la pensée du caractère
premier ou second de la différence se réfère, elle, au domaine de la métaphysique. La
conversation se prolonge et, Xabanú, en guise de synthèse, affirme:
«Pour qu'il y ait du noir, il faut qu'il y ait du blanc, pour qu'il y ait un oui, il faut qu'il y ait le
non, pour que le jaune existe, il faut que les autres couleurs existent. Et pour qu'il y ait une
montée? Il faut qu'il y ait une descente!». À ce moment, surprise par cette idée, Jamais
déclare: «Ah! Tout a son contraire». Suite à ce raisonnement, Christine apporte une
nouvelle idée: «On ne sait jamais si c'est une montée ou une descente». Et, au même
moment, Esdrubaldina se met à faire le poirier, traduisant ainsi les idées précédentes par
le biais du corps, soit en se mettant à l´envers, la tête en bas, pour indiquer quelque chose
qui est de l´ordre du contraire ou encore de l´inversion du sens.
Si mon but, pendant les séances, avait été d'enseigner aux enfants à penser selon un
modèle déterminé ou de les orienter vers une réponse donnée, j'aurais pu, en écoutant ces
idées, les juger fausses, et donc, je me serais opposée à la tournure que la conversation
était en train de prendre. Par exemple, vis à vis de l'idée qu'une montée puisse être la
même chose qu'une descente, idée accueillie avec un grand enthousiasme par les enfants,
mais inacceptable du point de vue de la logique du syllogisme, reposant sur le principe de
non-contradiction. Quoi qu'il en soit, quelque chose dans mon attitude, libre de tout
jugement, a permis aux enfants de poser et de développer le problème librement. Si l'on
pense aux processus artistiques décrits précédemment, notamment la manière dont Silvia
a géré les «erreurs», on peut remarquer des formes communes entre nos méthodes de
travail. En effet, en écoutant les enfants philosopher, quelque chose s'est produit en moi
de l´ordre de l´étonnement, si bien qu'immédiatement, ma pensée s'est élargie tout en
459