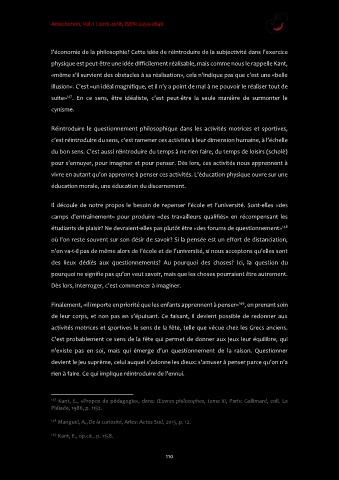Page 110 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 110
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
l’économie de la philosophie? Cette idée de réintroduire de la subjectivité dans l’exercice
physique est peut-être une idée difficilement réalisable, mais comme nous le rappelle Kant,
«même s’il survient des obstacles à sa réalisation», cela n’indique pas que c’est une «belle
illusion». C’est «un idéal magnifique, et il n’y a point de mal à ne pouvoir le réaliser tout de
147
suite» . En ce sens, être idéaliste, c’est peut-être la seule manière de surmonter le
cynisme.
Réintroduire le questionnement philosophique dans les activités motrices et sportives,
c’est réintroduire du sens, c’est ramener ces activités à leur dimension humaine, à l’échelle
du bon sens. C’est aussi réintroduire du temps à ne rien faire, du temps de loisirs (scholè)
pour s’ennuyer, pour imaginer et pour penser. Dès lors, ces activités nous apprennent à
vivre en autant qu’on apprenne à penser ces activités. L’éducation physique ouvre sur une
éducation morale, une éducation du discernement.
Il découle de notre propos le besoin de repenser l’école et l’université. Sont-elles «des
camps d’entraînement» pour produire «des travailleurs qualifiés» en récompensant les
148
étudiants de plaisir? Ne devraient-elles pas plutôt être «des forums de questionnement»
où l’on reste souvent sur son désir de savoir? Si la pensée est un effort de distanciation,
n’en va-t-il pas de même alors de l’école et de l’université, si nous acceptons qu’elles sont
des lieux dédiés aux questionnements? Au pourquoi des choses? Ici, la question du
pourquoi ne signifie pas qu’on veut savoir, mais que les choses pourraient être autrement.
Dès lors, interroger, c’est commencer à imaginer.
149
Finalement, «il importe en priorité que les enfants apprennent à penser» , en prenant soin
de leur corps, et non pas en s’épuisant. Ce faisant, il devient possible de redonner aux
activités motrices et sportives le sens de la fête, telle que vécue chez les Grecs anciens.
C’est probablement ce sens de la fête qui permet de donner aux jeux leur équilibre, qui
n’existe pas en soi, mais qui émerge d’un questionnement de la raison. Questionner
devient le jeu suprême, celui auquel s’adonne les dieux: s’amuser à penser parce qu’on n’a
rien à faire. Ce qui implique réintroduire de l’ennui.
147 Kant, E., «Propos de pédagogie», dans: Œuvres philosophes, tome III, Paris: Gallimard, coll. La
Pléïade, 1986, p. 1152.
148 Manguel, A., De la curiosité, Arles: Actes Sud, 2015, p. 12.
149 Kant, E., op.cit., p. 1158.
110