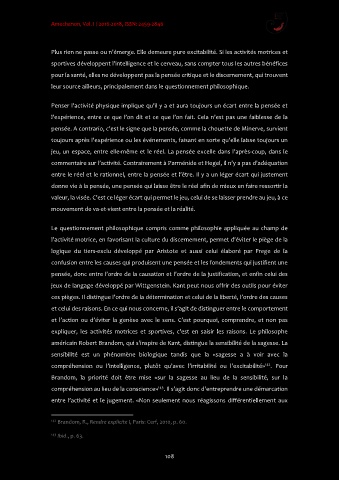Page 108 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 108
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
Plus rien ne passe ou n’émerge. Elle demeure pure excitabilité. Si les activités motrices et
sportives développent l’intelligence et le cerveau, sans compter tous les autres bénéfices
pour la santé, elles ne développent pas la pensée critique et le discernement, qui trouvent
leur source ailleurs, principalement dans le questionnement philosophique.
Penser l’activité physique implique qu’il y a et aura toujours un écart entre la pensée et
l’expérience, entre ce que l’on dit et ce que l’on fait. Cela n’est pas une faiblesse de la
pensée. A contrario, c’est le signe que la pensée, comme la chouette de Minerve, survient
toujours après l’expérience ou les événements, faisant en sorte qu’elle laisse toujours un
jeu, un espace, entre elle-même et le réel. La pensée excelle dans l’après-coup, dans le
commentaire sur l’activité. Contrairement à Parménide et Hegel, il n’y a pas d’adéquation
entre le réel et le rationnel, entre la pensée et l’être. Il y a un léger écart qui justement
donne vie à la pensée, une pensée qui laisse être le réel afin de mieux en faire ressortir la
valeur, la visée. C’est ce léger écart qui permet le jeu, celui de se laisser prendre au jeu, à ce
mouvement de va-et-vient entre la pensée et la réalité.
Le questionnement philosophique compris comme philosophie appliquée au champ de
l’activité motrice, en favorisant la culture du discernement, permet d’éviter le piège de la
logique du tiers-exclu développé par Aristote et aussi celui élaboré par Frege de la
confusion entre les causes qui produisent une pensée et les fondements qui justifient une
pensée, donc entre l’ordre de la causation et l’ordre de la justification, et enfin celui des
jeux de langage développé par Wittgenstein. Kant peut nous offrir des outils pour éviter
ces pièges. Il distingue l’ordre de la détermination et celui de la liberté, l’ordre des causes
et celui des raisons. En ce qui nous concerne, il s’agit de distinguer entre le comportement
et l’action ou d’éviter la genèse avec le sens. C’est pourquoi, comprendre, et non pas
expliquer, les activités motrices et sportives, c’est en saisir les raisons. Le philosophe
américain Robert Brandom, qui s’inspire de Kant, distingue la sensibilité de la sagesse. La
sensibilité est un phénomène biologique tandis que la «sagesse a à voir avec la
142
compréhension ou l’intelligence, plutôt qu’avec l’irritabilité ou l’excitabilité» . Pour
Brandom, la priorité doit être mise «sur la sagesse au lieu de la sensibilité, sur la
143
compréhension au lieu de la conscience» . Il s’agit donc d’entreprendre une démarcation
entre l’activité et le jugement. «Non seulement nous réagissons différentiellement aux
142 Brandom, R., Rendre explicite I, Paris: Cerf, 2010, p. 60.
143 Ibid., p. 63.
108