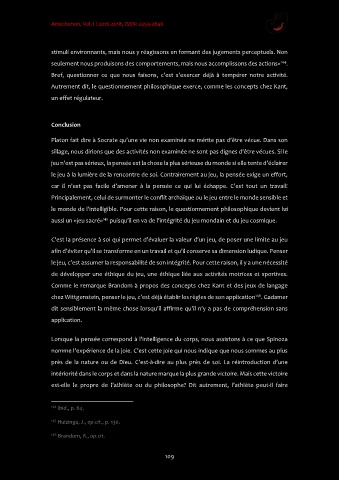Page 109 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 109
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
stimuli environnants, mais nous y réagissons en formant des jugements perceptuels. Non
144
seulement nous produisons des comportements, mais nous accomplissons des actions» .
Bref, questionner ce que nous faisons, c’est s’exercer déjà à tempérer notre activité.
Autrement dit, le questionnement philosophique exerce, comme les concepts chez Kant,
un effet régulateur.
Conclusion
Platon fait dire à Socrate qu’une vie non examinée ne mérite pas d’être vécue. Dans son
sillage, nous dirions que des activités non examinée ne sont pas dignes d’être vécues. Si le
jeu n’est pas sérieux, la pensée est la chose la plus sérieuse du monde si elle tente d’éclairer
le jeu à la lumière de la rencontre de soi. Contrairement au jeu, la pensée exige un effort,
car il n’est pas facile d’amener à la pensée ce qui lui échappe. C’est tout un travail!
Principalement, celui de surmonter le conflit archaïque ou le jeu entre le monde sensible et
le monde de l’intelligible. Pour cette raison, le questionnement philosophique devient lui
145
aussi un «jeu sacré» puisqu’il en va de l’intégrité du jeu mondain et du jeu cosmique.
C’est la présence à soi qui permet d’évaluer la valeur d’un jeu, de poser une limite au jeu
afin d’éviter qu’il se transforme en un travail et qu’il conserve sa dimension ludique. Penser
le jeu, c’est assumer la responsabilité de son intégrité. Pour cette raison, il y a une nécessité
de développer une éthique du jeu, une éthique liée aux activités motrices et sportives.
Comme le remarque Brandom à propos des concepts chez Kant et des jeux de langage
146
chez Wittgenstein, penser le jeu, c’est déjà établir les règles de son application . Gadamer
dit sensiblement la même chose lorsqu’il affirme qu’il n’y a pas de compréhension sans
application.
Lorsque la pensée correspond à l’intelligence du corps, nous assistons à ce que Spinoza
nomme l’expérience de la joie. C’est cette joie qui nous indique que nous sommes au plus
près de la nature ou de Dieu. C’est-à-dire au plus près de soi. La réintroduction d’une
intériorité dans le corps et dans la nature marque la plus grande victoire. Mais cette victoire
est-elle le propre de l’athlète ou du philosophe? Dit autrement, l’athlète peut-il faire
144 Ibid., p. 64.
145 Huizinga, J., op.cit., p. 130.
146 Brandom, R., op.cit.
109