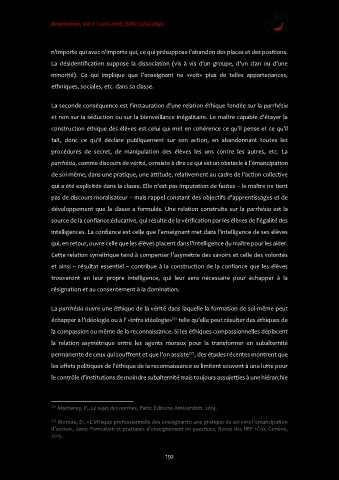Page 192 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 192
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
n’importe qui avec n’importe qui, ce qui présuppose l’abandon des places et des positions.
La désidentification suppose la dissociation (vis à vis d’un groupe, d’un clan ou d’une
minorité). Ce qui implique que l’enseignant ne «voit» plus de telles appartenances,
ethniques, sociales, etc. dans sa classe.
La seconde conséquence est l’instauration d’une relation éthique fondée sur la parrhésia
et non sur la séduction ou sur la bienveillance inégalitaire. Le maître capable d’étayer la
construction éthique des élèves est celui qui met en cohérence ce qu’il pense et ce qu’il
fait, donc ce qu’il déclare publiquement sur son action, en abandonnant toutes les
procédures de secret, de manipulation des élèves les uns contre les autres, etc. La
parrhésia, comme discours de vérité, consiste à dire ce qui est un obstacle à l’émancipation
de soi-même, dans une pratique, une attitude, relativement au cadre de l’action collective
qui a été explicitée dans la classe. Elle n’est pas imputation de fautes – le maître ne tient
pas de discours moralisateur – mais rappel constant des objectifs d’apprentissages et de
développement que la classe a formulés. Une relation construite sur la parrhésia est la
source de la confiance éducative, qui résulte de la vérification par les élèves de l’égalité des
intelligences. La confiance est celle que l’enseignant met dans l’intelligence de ses élèves
qui, en retour, ouvre celle que les élèves placent dans l’intelligence du maître pour les aider.
Cette relation symétrique tend à compenser l’asymétrie des savoirs et celle des volontés
et ainsi – résultat essentiel – contribue à la construction de la confiance que les élèves
trouveront en leur propre intelligence, qui leur sera nécessaire pour échapper à la
résignation et au consentement à la domination.
La parrhésia ouvre une éthique de la vérité dans laquelle la formation de soi-même peut
271
échapper à l’idéologie ou à l’ «infra-idéologie» telle qu’elle peut résulter des éthiques de
la compassion ou même de la reconnaissance. Si les éthiques compassionnelles déplacent
la relation asymétrique entre les agents moraux pour la transformer en subalternité
272
permanente de ceux qui souffrent et que l’on assiste , des études récentes montrent que
les effets politiques de l’éthique de la reconnaissance se limitent souvent à une lutte pour
le contrôle d’institutions de moindre subalternité mais toujours assujetties à une hiérarchie
271 Macherey, P., Le sujet des normes, Paris: Éditions Amsterdam, 2014.
272 Moreau, D., «L’éthique professionnelle des enseignants: une pratique de soi vers l’émancipation
d’autrui», dans: Formation et pratiques d’enseignement en questions, Revue des HEP n°20, Genève,
2015.
192