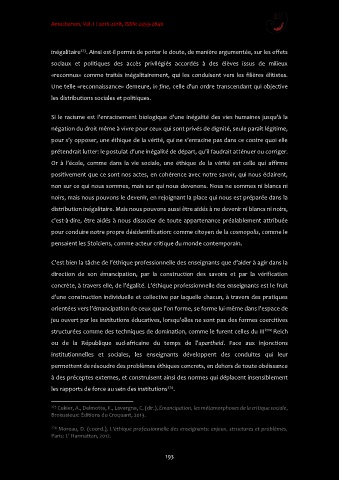Page 193 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 193
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
273
inégalitaire . Ainsi est-il permis de porter le doute, de manière argumentée, sur les effets
sociaux et politiques des accès privilégiés accordés à des élèves issus de milieux
«reconnus» comme traités inégalitairement, qui les conduisent vers les filières élitistes.
Une telle «reconnaissance» demeure, in fine, celle d’un ordre transcendant qui objective
les distributions sociales et politiques.
Si le racisme est l’enracinement biologique d’une inégalité des vies humaines jusqu’à la
négation du droit même à vivre pour ceux qui sont privés de dignité, seule paraît légitime,
pour s’y opposer, une éthique de la vérité, qui ne s’enracine pas dans ce contre quoi elle
prétendrait lutter: le postulat d’une inégalité de départ, qu’il faudrait atténuer ou corriger.
Or à l’école, comme dans la vie sociale, une éthique de la vérité est celle qui affirme
positivement que ce sont nos actes, en cohérence avec notre savoir, qui nous éclairent,
non sur ce qui nous sommes, mais sur qui nous devenons. Nous ne sommes ni blancs ni
noirs, mais nous pouvons le devenir, en rejoignant la place qui nous est préparée dans la
distribution inégalitaire. Mais nous pouvons aussi être aidés à ne devenir ni blancs ni noirs,
c’est-à-dire, être aidés à nous dissocier de toute appartenance préalablement attribuée
pour conduire notre propre désidentification: comme citoyen de la cosmopolis, comme le
pensaient les Stoïciens, comme acteur critique du monde contemporain.
C’est bien la tâche de l’éthique professionnelle des enseignants que d’aider à agir dans la
direction de son émancipation, par la construction des savoirs et par la vérification
concrète, à travers elle, de l’égalité. L’éthique professionnelle des enseignants est le fruit
d’une construction individuelle et collective par laquelle chacun, à travers des pratiques
orientées vers l’émancipation de ceux que l’on forme, se forme lui-même dans l’espace de
jeu ouvert par les institutions éducatives, lorsqu’elles ne sont pas des formes coercitives
structurées comme des techniques de domination, comme le furent celles du III ème Reich
ou de la République sud-africaine du temps de l’apartheid. Face aux injonctions
institutionnelles et sociales, les enseignants développent des conduites qui leur
permettent de résoudre des problèmes éthiques concrets, en dehors de toute obéissance
à des préceptes externes, et construisent ainsi des normes qui déplacent insensiblement
274
les rapports de force au sein des institutions .
273 Cukier, A., Delmotte, F., Lavergne, C. (dir.), Émancipation, les métamorphoses de la critique sociale,
Broisssieux: Éditions du Croquant, 2013.
274 Moreau, D. (coord.), L'éthique professionnelle des enseignants: enjeux, structures et problèmes,
Paris: L' Harmattan, 2012.
193