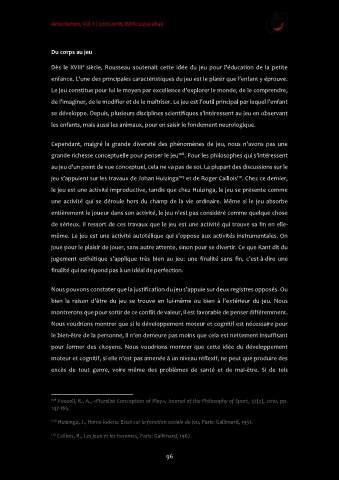Page 96 - Amechanon_vol1_2016-18
P. 96
Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
Du corps au jeu
e
Dès le XVIII siècle, Rousseau soutenait cette idée du jeu pour l’éducation de la petite
enfance. L’une des principales caractéristiques du jeu est le plaisir que l’enfant y éprouve.
Le jeu constitue pour lui le moyen par excellence d’explorer le monde, de le comprendre,
de l’imaginer, de le modifier et de le maîtriser. Le jeu est l’outil principal par lequel l’enfant
se développe. Depuis, plusieurs disciplines scientifiques s’intéressent au jeu en observant
les enfants, mais aussi les animaux, pour en saisir le fondement neurologique.
Cependant, malgré la grande diversité des phénomènes de jeu, nous n’avons pas une
108
grande richesse conceptuelle pour penser le jeu . Pour les philosophes qui s’intéressent
au jeu d’un point de vue conceptuel, cela ne va pas de soi. La plupart des discussions sur le
109
110
jeu s’appuient sur les travaux de Johan Huizinga et de Roger Caillois . Chez ce dernier,
le jeu est une activité improductive, tandis que chez Huizinga, le jeu se présente comme
une activité qui se déroule hors du champ de la vie ordinaire. Même si le jeu absorbe
entièrement le joueur dans son activité, le jeu n’est pas considéré comme quelque chose
de sérieux. Il ressort de ces travaux que le jeu est une activité qui trouve sa fin en elle-
même. Le jeu est une activité autotélique qui s’oppose aux activités instrumentales. On
joue pour le plaisir de jouer, sans autre attente, sinon pour se divertir. Ce que Kant dit du
jugement esthétique s’applique très bien au jeu: une finalité sans fin, c’est-à-dire une
finalité qui ne répond pas à un idéal de perfection.
Nous pouvons constater que la justification du jeu s’appuie sur deux registres opposés. Ou
bien la raison d’être du jeu se trouve en lui-même ou bien à l’extérieur du jeu. Nous
montrerons que pour sortir de ce conflit de valeur, il est favorable de penser différemment.
Nous voudrions montrer que si le développement moteur et cognitif est nécessaire pour
le bien-être de la personne, il n’en demeure pas moins que cela est nettement insuffisant
pour former des citoyens. Nous voudrions montrer que cette idée du développement
moteur et cognitif, si elle n’est pas amenée à un niveau réflexif, ne peut que produire des
excès de tout genre, voire même des problèmes de santé et de mal-être. Si de tels
108 Feezell, R., A., «Pluralist Conception of Play», Journal of the Philosophy of Sport, 37(2), 2010, pp.
147-165.
109 Huizinga, J., Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris: Gallimard, 1951.
110 Caillois, R., Les jeux et les hommes, Paris: Gallimard, 1967.
96